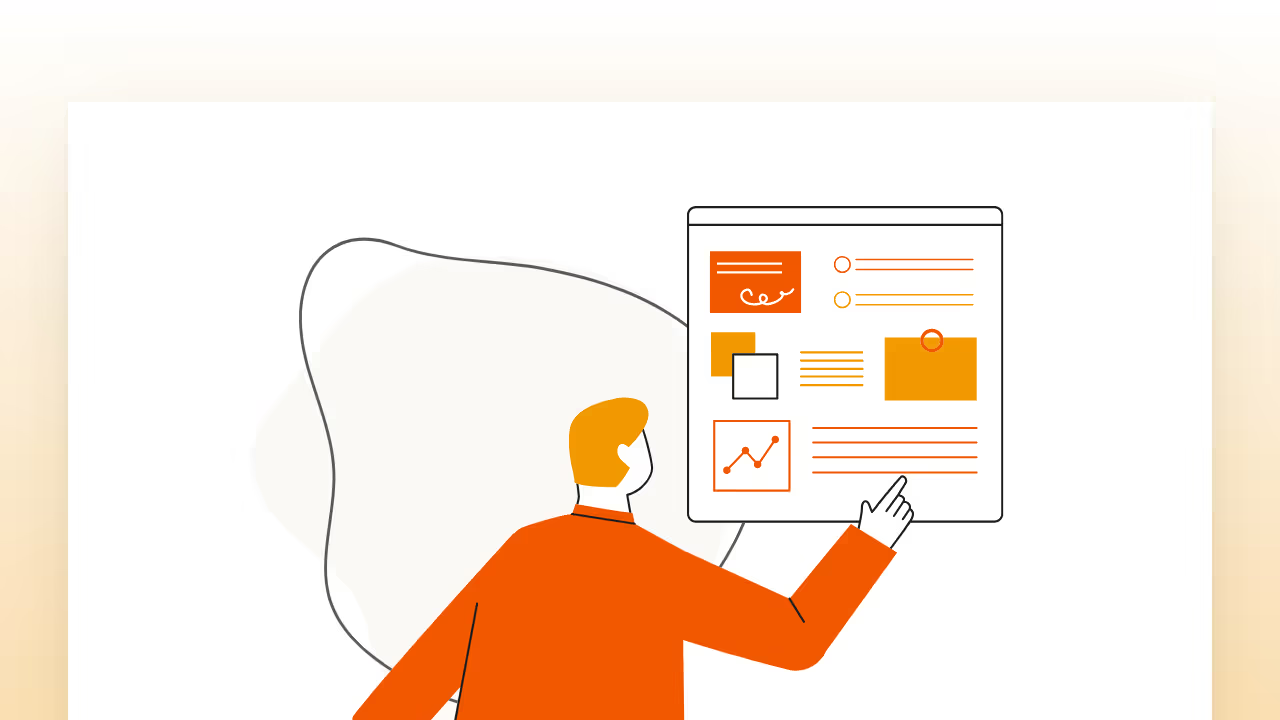Entretien avec Anne-Yvonne GUÉGAN-ROUÉ, Cheffe du Service SIG | Manche Numérique/Conseil départemental de la Manche | 9 juin 2021

Aujourd’hui, les patrimoines de données géographiques des organismes restent fréquemment méconnus. Les données sont en effet souvent dupliquées, leurs sources multipliées, et l’expansion des liens d’interdépendance entre les différentes structures manipulant de l’information géographique complexifie les réseaux d’acteurs concernés.
Dans ce contexte et face à l’évolution constante du monde du SIG (déclin de la Directive INSPIRE, affirmation de l’open data, développement du BIM et du catalogage global de données…), Mathieu Becker (Isogeo) et Hervé Halbout (Halbout Consultants) se sont lancés dans l’actualisation du livre blanc sur la gouvernance des données géographiques publié en 2016.
Cette édition 2021 est alimentée par de nombreux entretiens avec des professionnels issus ou non du monde de la géomatique. Ces entretiens ont soigneusement été retranscrits au sein de l'annexe du livre blanc prévue pour début mars 2022.
En voici un premier exemple ci-dessous !
Extrait de l'annexe du livre blanc sur la gouvernance de données géographiques : entretien avec Anne-Yvonne GUÉGAN-ROUÉ, cheffe du service SIG | Manche Numérique/Conseil départemental de la Manche |9 juin 2021
Pour vous, qu’est-ce que la gouvernance des données géographiques ?
Dans « gouvernance », on entend « gouverner ». La gouvernance associe une organisation avec des acteurs, des données, des outils et un processus de prise de décision et de pilotage pour produire, diffuser et exploiter la donnée géographique.
Qui dit gouvernance, dit structure de décision qui associe, dans une collectivité, des services et des élus pour définir une stratégie commune, organiser l’information géographique et mettre en place une feuille de route...
La gouvernance, c’est l’organisation, le pilotage et la planification. Certaines collectivités ont pour cela établi un schéma directeur de l’information géographique qui leur permet d’avoir une lisibilité à 4-5 ans sur les orientations à donner et les actions à engager pour leur SIG.
Au niveau national, le CNIG doit pouvoir assurer cette gouvernance de l’information géographique. En Région Normandie, la CRIGE joue en partie ce rôle. Cependant, si l’organisation et le réseau d’acteurs sont en place, il lui manque la composante décisionnelle pour assurer pleinement un rôle de gouvernance à l’échelle de la région.
Notion de patrimoine de données géographiques (connaissance, exploitation, valorisation) :
Le catalogage est un outil pour la connaissance du patrimoine de données au sein d’une organisation qui permet de faciliter l’accès aux jeux de données et de définir leurs modalités de diffusion à l’extérieur. Il permet d’expliquer la donnée, de définir son accessibilité et son niveau de diffusion, d’y associer des ressources complémentaires. Donner accès à la donnée, la documenter, est primordial si l’on veut qu’elle soit largement et correctement utilisée.
Le catalogage est un outil de gestion et de pilotage du patrimoine de données qui participe à la gouvernance de l’information géographique. Il n’est pas la gouvernance elle-même, mais en est un composant essentiel à sa mise en œuvre et à son fonctionnement.
Comment faire remonter la problématique de la gouvernance des données au niveau des élus ?
C’est difficile, car les élus ne sont pas toujours très bien informés de la pertinence de la donnée géographique.
C’est aujourd’hui compliqué de faire ressortir la spécificité de la donnée géographique par rapport aux données au sens large, d’autant plus qu’un grand nombre d’entre elles peut aujourd’hui être facilement géolocalisé (capteurs).
La data est partout et la donnée d’observation, par la construction d’indicateurs dynamiques, est celle qui semble intéresser particulièrement les élus pour la gestion de leur territoire. La consommation des données sous forme de flux la rend de plus en plus accessible pour tous. Il n’est désormais plus nécessaire d’être un spécialiste pour exploiter de la donnée géolocalisée.
Pour autant, la construction de référentiels géographiques s’inscrit dans le temps long et nécessite un certain niveau d’expertise. Il faut du temps et des moyens pour collecter une donnée terrain, la qualifier, la vérifier, la structurer et la stocker en base et enfin l’exploiter et la mettre à jour.
Le maire d’une commune va être plus intéressé par une donnée rapidement mesurée et actualisée dynamiquement dont il voit l’intérêt immédiat pour la gestion de son territoire.
Ce sera plus compliqué de le mobiliser sur des thématiques de constitution de fonds de plans de référence (exemple actuellement pour la constitution du PCRS) qui vont demander du temps, de l’argent, qui sont parfois complexes à expliquer et dont les retombées en termes d’usages ne sont pas immédiates.
Pour autant, qu’elles soient dynamiques ou plus « statiques », toutes ces données sont des données descriptives d’un territoire et sont complémentaires. Il importe de travailler sur cette complémentarité pour convaincre les élus de l’importance d’organiser et de gérer toute la palette de données collectées sur un territoire. La gouvernance à leur niveau est la condition pour gérer correctement ce patrimoine de données, le connaître, et savoir comment le valoriser et l’exploiter pour en extraire les données pertinentes à la gestion de leur territoire.
Comment voyez-vous l’évolution du rôle du géomaticien ?
Il est difficile de généraliser tant la fonction du géomaticien diffère d’une collectivité à une autre en fonction de la taille, des moyens et du niveau d’expertise de celle-ci. Il y a un décrochage perceptible entre les grandes métropoles et les autres territoires.
Certaines grandes villes, avec une expertise de plus en plus pointue et des moyens techniques et financiers importants, se lancent dans des programmes ambitieux. L’intérêt de ces projets est évident, mais reste en complet décalage avec la réalité de très nombreuses collectivités qui ont encore du mal à faire émerger, en leur sein, un intérêt pour les données géographiques. Le fossé se creuse entre les territoires qui bénéficient d’une connaissance et d’un suivi riche et détaillé en données, et ceux qui peinent à collecter et maintenir des données de base.
Cette évolution se retrouve au niveau des géomaticiens, les uns, de plus en plus spécialisés, avec de nouvelles compétences autour de la data (Data Chief Officer, Data Scientist, BIM, décisionnel…), les autres, plus généralistes, avec des ressources beaucoup plus limitées et qui n’ont ni le temps, ni la capacité de devenir experts sur tous ces domaines.
La question est de savoir si le géomaticien a vocation à devenir un expert (BIM, LIDAR, IA…), ou si son rôle n’est pas plutôt celui d’un « chef d’orchestre » à même de mobiliser des compétences/expertises plus larges sur le travail autour de la donnée : savoir faire un tri pertinent dans la masse des données produites par son organisation, réfléchir aux vrais besoins en termes de données pour ne garder et valoriser que celles véritablement utiles et pour lesquelles une mise à jour pourra être assurée au sein de son organisation… Le géomaticien doit pouvoir assurer cette vigilance et être garant de ces « process » auprès des services métier.
Dans tous les cas, il devra prendre de la hauteur par rapport à ses fonctions habituelles, pour avoir un point de vue plus large, ouvert à d’autres sources de production de données, tourné vers des utilisateurs plus nombreux, différents de ceux avec lesquels il a l’habitude de travailler, et qui ont des attentes nouvelles liées aux nouvelles formes de consommation des données.

.avif)