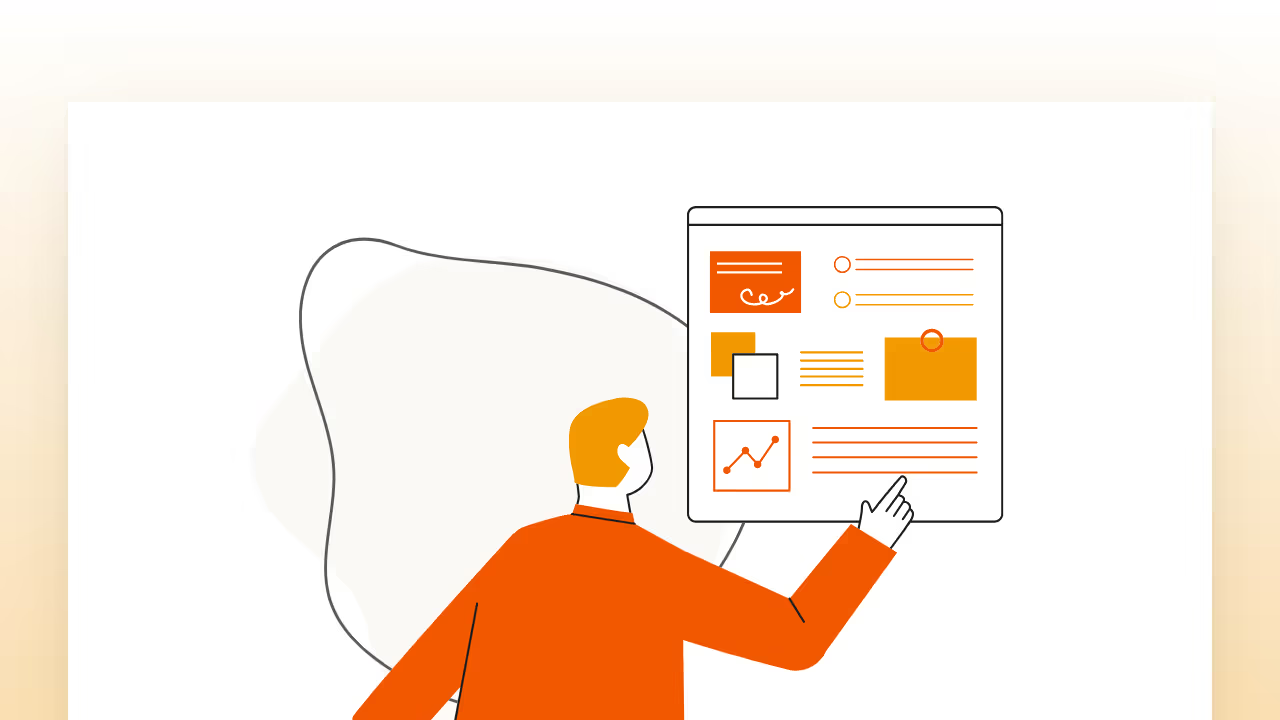Extrait de l'annexe du livre blanc sur la gouvernance des données géographiques : entretien avec Luc Vaillancourt | BALIZ | 03 et 07 juin 2021

Le livre blanc sur la gouvernance des données géographiques de Mathieu Becker (Isogeo) et Hervé Halbout (Halbout Consultants) aborde de nombreuses questions :
- Quels sont les nouveaux enjeux de la gouvernance des données géographiques ?
- Comment peut-on la mettre en place et quels bénéfices peut-on en retirer dans le cadre d’un projet SIG, d’une IDG ou encore d’un projet open data ?
- À quels défis les géomaticiens seront-ils confrontés dans les années à venir ?
Alimentée par de nombreux entretiens avec des professionnels issus ou non du monde de la géomatique, l'édition 2021 de ce livre blanc évoque également des notions émergentes dans le monde de la géomatique, comme la qualité des données, l’écologie, l’éthique et la place des données géographiques dans les projets de catalogage global.
Ces entretiens ont soigneusement été retranscrits au sein de l'annexe du livre blanc, téléchargeable gratuitement sur le site d'Isogeo.
En voici un exemple ci-dessous !
EXTRAIT DE L'ANNEXE DU LIVRE BLANC SUR LA GOUVERNANCE DES DONNÉES GÉOGRAPHIQUES : ENTRETIEN AVEC LUC VAILLANCOURT, PDG | BALIZ | 03 ET 07 JUIN 2021
Pour vous, qu’est-ce que la gouvernance de l’information géographique / des données géographiques ?
Plus la valeur d’un actif est (ou est perçue) comme importante, plus des efforts entourant sa gouvernance y seront investis. L’information géographique devrait être considérée comme un actif important dans toute organisation, au même titre que les actifs physiques (comme les infrastructures). Toute proportion gardée, ces actifs informationnels méritent leur gouvernance.
Sans entrer dans toutes les facettes de la gouvernance, ma philosophie tourne autour de « valoriser l’existant, pour justifier les investissements futurs ».
Cette notion de gouvernance doit reposer sur ce besoin initial de réaliser et de maintenir un inventaire des données, afin de mieux communiquer sur ces actifs informationnels. En utilisant par exemple un outil Web de catalogage, cela permet la mise en vitrine du contenu, pour le faire connaître, faciliter la découverte et stimuler les usages, internes et peut-être externes.
Ce qui ne se mesure pas ne se gère pas. Bien que cette opération de catalogage soit perçue comme fastidieuse par les professionnels du géospatial, il faut implémenter ces concepts de métadonnées dans le but de valoriser ces actifs informationnels. Pour faciliter l’exercice, il n’est pas nécessaire de tout cataloguer en détail au départ. Il faut plutôt cataloguer les jeux de données les plus importants, avec quelques métadonnées essentielles, et commencer à intéresser les utilisateurs. Le catalogage est ainsi indispensable, même si son alimentation est souvent considérée comme un fardeau. Il devrait par ailleurs se faire en plusieurs phases (selon une méthode agile). Tout vouloir faire d’un coup et de manière complète/détaillée est en effet voué à l’échec.
Ainsi, la connaissance partagée des données et de leur documentation permet de choisir ce qu’il faut pour faire une bonne carte. En pâtisserie, avec les bons ingrédients, je peux faire une bonne tarte, mais avant de cuisiner, je dois connaître la liste de ce dont je dispose.
L’inventaire concerne les données (disponibles en fichiers ou via des services Web de contenu), mais également les cartes et les applications exploitant ces données géographiques.
Un catalogue animé et attractif peut aussi aider les géomaticiens dans leur propre promotion. C’est une façon de faire valoir leur expertise, être de meilleurs promoteurs en interne auprès des collègues et à l’externe dans tout l’écosystème pertinent au domaine.
Au-delà d’une vitrine promotionnelle, le catalogue (données, cartes, services, APIs et applications) devient aussi un outil de gestion et de planification pour le financement de son contenu, des technologies et des travaux associés. La visibilité (les usages et la popularité) contribue à justifier le financement tout au long du processus, de la création, la mise à jour et la diffusion des données.
Il faut prendre soin d’un catalogage de données en pensant à toutes les parties prenantes : les producteurs (comprendre l’intérêt de documenter la donnée), les bailleurs de fonds (apprécier, mesurer la richesse informationnelle), les bénéficiaires et utilisateurs finaux (promotion et communication, pour faire savoir/faire valoir).
Un catalogue de données, c’est aussi un peu du marketing. Du marketing de contenu, comme du marketing de compétences, celles des géomaticiens et autres spécialistes du territoire.
Un catalogue représente un important module d’une infrastructure de données spatiales (IDS ou SDI en anglais pour Spatial Data Infrastructure). Une IDS complète met non seulement en valeur les données, mais aussi les utilisateurs, les contributeurs et les organisations (les sources).
Il peut être intéressant d’utiliser de simples concepts que l’on retrouve dans les médias sociaux comme les « likes » ou une cote « nombre d’étoiles » pour signifier la pertinence et la popularité d’un jeu de données, d’une carte ou d’une application. Les utilisateurs de données peuvent ainsi influencer l’usage des données (ce qui est fiable, ce qui est populaire, ce qui est nouveau, etc.). C’est une bonne façon de valoriser les professionnels qui ont travaillé sur les données, les organisations qui les ont financées. Il faut communiquer et animer un catalogue. C’est un travail à part entière. Si un contenu est apprécié et populaire, il sera de plus en plus utilisé, garantissant sa maintenance et sa pérennité.
Réflexions sur la donnée :
Il y a trois grandes phases à prendre en compte actuellement autour de la donnée :
- La production/création ;
- La transformation/valorisation ;
- L’utilisation/livraison du contenu/service associé.
La chaîne de valeur est donc assez longue, mais ces trois phases mériteraient autant de ressources (temps et argent) l’une que l’autre.
La première phase est bien couverte et identifiée (beaucoup d’efforts et de financements).
Le deuxième, c’est celle qui transforme et donne vie aux données : intégration, qualité, analyse, fusion et croisement, valorisation… Elle manque de financements et de compétences, comparée à la phase de production.
La troisième phase, c’est la finalité : la mise en disponibilité, la diffusion dans des géoportails, des catalogues, des cartes dynamiques et applications de visualisation/interrogation… Il y a plus d’applicatifs simples de découverte et de visualisation que d’applications maximisant vraiment des traitements avancés.
Il y a ainsi un déséquilibre dans la chaîne de production/transformation/usage de la donnée. Actuellement, on crée toujours et de plus en plus de données, mais le marché ne semble pas suivre le même rythme, et les données ne sont pas rendues disponibles au même rythme.
Il y a de plus en plus de captures (le 3D par exemple), mais également un décalage dans les capacités globales d’en retirer des informations fiables et actualisées sur un temps court (ou en temps réel). Cela pose la question : pourquoi augmenter encore l’input, alors qu’il y a déficience dans l’output ? Ou pourquoi ne pas investir davantage pour rehausser le niveau du côté traitement et usage ?
Il faut aussi savoir faire un choix au niveau du partage et de l’ouverture des données (open data ou même partage en interne à un organisme public ou privé) : qu’est-ce que je peux montrer ou pas ?
Cela pose la question de la granularité de gestion de qui a accès à quoi : des collègues ? Des citoyens ? Des décideurs ?
Il y a différents types d’utilisateurs :
- Les géomaticiens veulent de la donnée, en fichiers, services Web, ou les deux ;
- Les développeurs veulent des API’s et services Web pour enrichir les applications (ils sont plus nombreux que les géomaticiens) ;
- Les utilisateurs finaux (encore plus nombreux) veulent juste utiliser des applications exploitant des données fiables. Ils veulent savoir et obtenir des réponses.
Tous ces éléments autour de « partager quoi avec qui » sont à prendre en compte dans le cadre de la gouvernance sur les données, qu’elles soient géographiques ou non.
Comment faire remonter la problématique de la gouvernance des données au niveau des élus ?
La géomatique est énergivore en termes de données. Contrairement à d’autres disciplines, elle exige à la fois des données descriptives (des chiffres et des lettres) et des données géométriques (formes et positions). En plus, la géomatique a besoin de données de base pour illustrer le contexte géographique et de données thématiques ou « métier » pour bien traiter et illustrer le sujet « en vedette » dans la carte ou l’application.
Comment voyez-vous l’évolution du rôle du géomaticien ?
D’un point de vue expertise, le géomaticien se distingue selon son propre mix de compétences, en cartographie, en analyse spatiale, en cartographie thématique, en statistiques, en gestion de bases de données, en Web-mapping, en communication graphique…
Le géomaticien peut rester génériquement fort s’il travaille avec des experts complémentaires dans certaines thématiques (transports, environnement, commerce de détail, ingénierie…).
Le géomaticien peut avoir à verticaliser ses connaissances s’il doit jouer le rôle d’expert du métier ou du thème en question.
Le géomaticien se met en valeur et met en valeur les données et les contenus via une vitrine catalogue. Il peut exposer et présenter des actifs telle une boutique de commerce électronique. Il informe sur les nouveautés, les meilleurs vendeurs, les incontournables (couches de base), les collections (les thèmes), les manufacturiers (les sources)… Il facilite la découverte et stimule les usages.
Le géomaticien est débrouillard et il sait comment exploiter et maximiser l’intelligence territoriale existante, sans toujours demander plus de données. Il sait quoi mettre à jour, il sait qui intéresser, il sait qui convaincre.
Le géomaticien sait faire du marketing numérique, du marketing de contenu, du storytelling sur les bonnes pratiques et les histoires à succès. Cette animation peut se faire dans l’intranet de l’organisation pour laquelle il travaille, autant que, si possible, sur Internet et les médias sociaux.
Le géomaticien sait bien gérer son temps, les tâches selon la matrice urgence/importance, le ratio efforts/résultats. Le géomaticien est agile, il essaye, il se trompe rapidement et recommence.
Le géomaticien sait comment gérer et obtenir du financement pour ses activités, son équipe, ses technologies, ses données, ses applications… et garantir leur pérennité.
.avif)